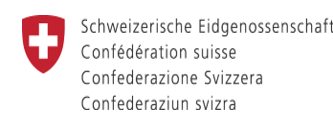Introduction
Dans le cadre du projet Gérer les Risques et les Ressources dans la Région Sud (GÉRER-SUD), la Coopération Suisse en Haïti, s’engage à collaborer avec les communautés locales et les différents acteurs régionaux et locaux afin de renforcer la résilience des populations rurales à travers la gouvernance des risques et la gestion intégrée des ressources (sols, eaux). Cet engagement vise également à assurer une meilleure participation des femmes et des groupes vulnérables dans les processus engagés, dans le but d’améliorer leur résilience face aux catastrophes. Le projet GÉRER-SUD est à sa première phase opérationnelle articulée autour de deux axes principaux poursuivant chacun un effet :
• Effet 1 : Les acteurs locaux identifient les risques liés aux aléas naturels, s’y préparent et y répondent de manière inclusive et adaptée (gouvernance des risques).
• Effet 2 : Les acteurs locaux, et en particulier les groupes de femmes, bénéficient de services EHA résilients, ainsi que de pratiques durables contribuant à la protection des ressources naturelles (gestion intégrée des ressources).
Le renforcement de la gouvernance des risques : Le projet renforcera la connaissance des aléas naturels et améliorera la préparation face aux désastres, tant au niveau des autorités régionales et locales qu’au sein des communautés. Cet effort s’accompagnera de la construction d’abris multifonctionnels, conçus pour servir à la fois de refuge en cas de catastrophe et d'espaces communautaires en temps normal. Lorsque nécessaire, des travaux seront entrepris pour améliorer les voies d’accès vers les abris et les infrastructures essentielles, facilitant ainsi l’évacuation et l’accès aux services de base en situation d’urgence. Le projet s'attachera à réduire l’exposition de l’habitat et des voies d’accès aux dangers naturels en mettant en place des mesures de mitigation pour protéger les zones d'habitation et des voies d’accès particulièrement exposées aux aléas naturels et identifiées comme critiques par les communautés.
La promotion de la gestion durable des ressources : Le projet travaillera sur la gestion durable des ressources en eau, en développant ou en réhabilitant des infrastructures adaptées et en renforçant les capacités locales en matière de gestion communautaire de l’eau. Cette approche se concentrera sur la collecte, le transport et la distribution d’eau, mais aussi sur des projets de promotion de l’hygiène et de latrines communautaires (e.g., centres scolaires et médicaux). Des actions de conservation de l’eau et des sols (CES) seront mises en œuvre afin de préserver les ressources naturelles et limiter l’érosion des sols. Le projet soutiendra, en particulier avec les groupes de femmes, la valorisation des produits locaux, en promouvant des initiatives pour le stockage et la transformation des produits agro-sylvo-pastoraux. De plus, il appuiera des espaces de dialogue communautaires pour renforcer l’utilisation et la maintenance des infrastructures communautaires.
Le programme GERER-SUD est mis en œuvre de façon directe par la Coopération suisse en Haïti via son Bureau de Projet Direct de Port-Salut. Il se concentre sur 5 communes du département du Sud (côte Sud-ouest), à savoir Les Anglais, Chardonnières, Port-à-Piment, Côteaux et Roche-à-Bateaux.
2. Justificatif du mandat
Le projet GÉRER-Sud vise à renforcer la résilience des populations rurales du département du Sud en s’appuyant sur deux axes complémentaires : la gestion des risques liés aux catastrophes naturelles et la gestion durable des ressources naturelles. Conçu comme un projet transformatif de genre, il accorde tout au long de sa mise en œuvre une attention particulière aux femmes et aux groupes vulnérables. L’objectif de cette démarche transformative est de favoriser une meilleure participation de ces groupes à la vie politique et économique des communautés, afin d’améliorer leur résilience face aux catastrophes naturelles. Ces dimensions nécessitent une approche transversale intégrant le genre, notamment par la valorisation de nouveaux modèles sociaux dans différents domaines, y compris dans les métiers traditionnellement masculins. C’est une approche qui vise à déconstruire les stéréotypes liés aux métiers traditionnellement masculins, à ouvrir de nouvelles perspectives économiques pour les femmes et à créer de nouveaux modèles sociaux. L’initiative s’articule directement avec la stratégie nationale de formation professionnelle pilotée par le Ministère de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle (MENFP) et mise en œuvre par l’Institut National de Formation Professionnelle (INFP), qui vise la modernisation des dispositifs de formation et leur adéquation avec les besoins réels du marché du travail. Elle répond également aux orientations du Plan National d’Éducation et de Formation Professionnelle (PNEFP), qui encourage la diversification des profils techniques et l’intégration des femmes dans les métiers porteurs. Dans un contexte où les catastrophes liées aux aléas naturels fragilisent les infrastructures et les moyens de subsistance, la formalisation et la certification des formations dans la construction constituent un levier essentiel de la stratégie nationale de relance économique post-désastres, en favorisant la reconstruction résiliente, la création d’emplois décents et la valorisation du capital humain féminin. Ce plan s'inscrit dans le cadre du Plan Décennal d'Éducation et de Formation (PDEF) 2019-2029 et met l'accent sur le développement professionnel des enseignants, l'amélioration des programmes d'enseignement et la formation professionnelle, tout en soulignant les défis liés à l'emploi et à l'employabilité des jeunes.
La certification des formations dans le secteur de la construction s’inscrit dans cette dynamique en cherchant à ouvrir des espaces professionnels historiquement masculins aux femmes. La politique nationale élaborée par le Ministère à la Condition Féminine et aux Droits des Femmes (MCFDF), vise à éliminer les discriminations entre les sexes et à promouvoir l’égalité dans divers domaines, y compris l’éducation et la formation professionnelle. Elle encourage la mise en œuvre de mesures structurantes pour garantir l’accès des femmes aux formations techniques et professionnelles, en particulier dans les secteurs historiquement monopolisés par les hommes. De plus, la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDEF), ratifiée par Haïti en 1981, engage l’État à prendre toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes, y compris dans le domaine de l’éducation et de la formation professionnelle, en assurant des conditions égales d’accès à la formation et à la reconversion. Ces cadres politiques et juridiques démontrent l’engagement des acteurs gouvernementaux et internationaux à promouvoir l’égalité des sexes dans le domaine de la formation professionnelle.
Le projet Gérer Sud prévoit la sélection d’au moins vingt femmes afin de les former dans des métiers traditionnellement masculins. Afin de garantir que les compétences développées soient reconnues et valorisées sur le marché du travail, il est nécessaire de conduire une étude permettant d’identifier les voies de certification les plus adaptées ainsi que les modalités institutionnelles et partenariales associées. Dans ce contexte, la certification des formations dispensées aux femmes dans le cadre de GÉRER SUD contribuera à la durabilité des acquis, à la reconnaissance des compétences développées et au renforcement des capacités locales. Elle favorisera également l’élargissement des opportunités économiques pour les femmes dans un secteur clé du développement, soutenant ainsi une dynamique de transformation sociale et économique fondée sur l’égalité, la résilience et l’inclusion.
Parallèlement à cette étude, une collecte de données a été menée afin d’examiner l’intérêt et le potentiel d’intégration des femmes dans des métiers généralement perçus comme masculins dans le cadre des activités du projet GERER SUD. Cette démarche visait à documenter la disponibilité locale de compétences, les dynamiques sociales influençant l’accès des femmes à ces métiers et les conditions nécessaires pour favoriser leur participation. Les activités réalisées incluent des entretiens dans vingt-quatre localités réparties dans deux sections communales, l’analyse de la demande locale en main-d’œuvre, l’identification de l’offre de formation existante, ainsi qu’un appel à manifestation d’intérêt directement adressé aux femmes de deux des localités ciblées par le projet, notamment Belle Dent (Chardonnières) et Sentiment (Port à Piment). Des groupes de discussion ont également permis d’explorer la perception sociale de la masculinité associée à certains métiers, les compétences déjà présentes chez les femmes, leurs éventuels besoins en formation, et les obstacles et opportunités liés à leur intégration professionnelle.
Des données issues d’un focus group mené auprès de représentantes d’organisations de femmes dans la commune de Port à Piment, à Sentiment particulièrement, le 22 aout 2025, montrent l’existence de femmes artisanes actives dans des métiers techniques (maçonnerie, ferraillage, carrelage). Si certaines disposent déjà d’une formation professionnelle, la majorité ont appris directement sur les chantiers et ont identifié des barrières comme l’absence de réseau professionnel et le maintien de normes sociales limitant leur participation. Il existe également une demande locale et un intérêt exprimé par les femmes pour l’accès à des formations complémentaires dans d’autres métiers du secteur. Ces constats confirment la pertinence d’un dispositif de formation certifiant et d’un accompagnement à l’intégration professionnelle, afin de faciliter l’accès des femmes aux chantiers liés aux infrastructures du projet.
Notons aussi que ce mandat permet de relier les besoins opérationnels du projet (des professionnels.les dans le secteur de la construction) et le renforcement de capacités à travers des activités de formation. En permettant à des femmes d’avoir accès à ces formations techniques nécessaires à la construction et l’entretien des infrastructures, il permet aussi d’intégrer la dimension genre et inclusion dans les activités de gestion des risques et des ressources d’une part et d’autre part de transformer ces formations en opportunités d’autonomisation économique pour les femmes particulièrement.
Fonctions
Résumé du poste :
Etablir une cartographie des centres de formation professionnelle dans la zone sud offrant des formations en lien avec les activités du projet notamment la construction ;
Analyser les conditions et critères permettant la reconnaissance ou la certification des formations courtes ;
Établir un cadre stratégique et opérationnel pour la co-certification ou la certification des formations ;
Proposer un document de formation complet conforme aux standards de l’INFP pour les thématiques non couvertes dans les cursus des centres de formation professionnelle sans nécessité de développement des contenus.
Le prestataire est invité à proposer une stratégie globale visant à :
Renforcer la pertinence et la qualité des programmes de formation dans le cadre du projet ;
Faciliter la reconnaissance et la certification des parcours de formation ;
Proposer des critères de sélection des candidates, notamment pour celles déjà engagées dans les métiers techniques ;
Proposer des initiatives de sensibilisation auprès des institutions, des communautés et des centres de formation afin de soutenir l’adoption de référentiels sensibles au genre et à l’inclusion
La firme ou l’équipe de consultants.tes est chargé de conduire la mission tout en assurant la liaison avec les institutions partenaires et les acteurs.trices locaux.les et en veillant à l’atteinte des objectifs et à la qualité des livrables. Sa responsabilité principale est de produire un diagnostic complet sur les formations techniques, leurs modalités de certification et l’intégration des femmes dans les métiers liés au secteur de la construction, et de proposer un plan de mise en œuvre opérationnel.
Plus spécifiquement :
Planifier les activités, organiser les réunions de suivi avec les parties prenantes et veiller au respect du calendrier et des échéances ;
Collecter et analyser les données (consultations, revues documentaires etc.) et développer la stratégie ;
Produire les recommandations, documents techniques et guides opérationnels, et proposer des modalités de pérennisation et de mise à l’échelle ;
Garantir la rigueur méthodologique, la conformité aux critères qualité, la cohérence avec les approches transversales (genre, inclusion, GPSC, Nexus) et les normes nationales ;
Animer les ateliers, assurer un suivi régulier auprès du projet et remettre le rapport final ainsi que l’ensemble des livrables attendus ;
Proposer des adaptations le cas échéant en fonction des contraintes, des priorités du projet et des retours des parties prenantes.
1. Rapport de diagnostic et cartographie des centres de formation professionnelle des communes d’intervention de GÉRER SUD et dispositifs de certification potentiels ;
2. Guide méthodologique pour harmoniser les programmes de formation existants avec le référentiel national ;
3. Analyse des thématiques non couvertes par les cursus actuels avec proposition d’un plan de formation adapté aux besoins de GÉRER SUD ;
4. Document stratégique présentant les modalités de co-certification ou de certification des formations avec recommandations pour les partenariats avec les centres de formation et la documentation des bonnes pratiques, des défis et des conditions de durabilité de la stratégie ;
5. Rapport final de mission incluant les recommandations, un plan de mise en œuvre future et des propositions de pérennisation :
• Un résumé de la mission ;
• La description des objectifs de l’étude et de la méthodologie utilisée ;
• Les résultats principaux ;
• Les considérations générales sur la formalisation, les modalités de certifications (avantages et défis) ;
• Les conclusions et les recommandations générales notamment un modèle opérationnel d’intégration sur les chantiers ;
• En annexe les fiches suivantes (Guide pour intégrer la dimension de genre dans les modules du projet, Plan de sensibilisation destiné aux acteurs institutionnels en lien à la prise en compte du référentiel genre et inclusion dans les documents de formation sur la construction).
Qualifications réquises
Compétences et qualifications requises :
Spécialisation en formation professionnelle, gestion de projets de développement, ingénierie de formation ou renforcement institutionnel, avec au moins cinq ans d’expérience ;
Expérience avérée dans la réalisation de projets similaires et prise en compte de la dimension genre ;
Connaissance des acteurs publics et privés du secteur de la formation professionnelle haïtien et du système de certification (INFP, MENFP) ;
Compétences en rédaction de documents techniques de haute qualité, avec maîtrise du français et créole ;
Aptitudes en négociation institutionnelle et en établissement de partenariats stratégiques ;
Bonne connaissance des programmes de développement et des problématiques du secteur de la construction en Haïti
Dossier d’appel d’offres
Envoyer le pli à
ddc-portsalut-haiti@sha.admin.ch
Ouverture de pli
28/11/2025 à 08:00
Remarques contact
Référence de l’appel d’offres : Projet GERER SUD/Modalités de certification/formation/2025.
Autres remarques
Soumission des offres
L’offre doit contenir :
a) Une proposition technique présentant les points ci-dessus :
Une lettre de soumission ;
Un chapitre sur la compréhension du mandat ;
La méthodologie proposée ;
Le chronogramme d’activité (ne dépassant pas 35 jours)
CV des consultants.tes de la firme ou de l’équipe de consultants.tes;
Les documents légaux (patente) (si firme) et patente professionnelle du.de la consultant.e principal.e (si équipe de consultants.tes) ;
Trois (3) références professionnelles ;
Des exemples de prestations réalisées dans ce domaine
b) Une offre financière comprenant une estimation des coûts liés à la prestation. Notons aussi que l’évaluation financière sera réalisée uniquement pour les offres jugées techniquement recevables.
Cas de rejet des offres
Les offres pourront être rejetées pour les causes suivantes, la liste ci-dessous n’étant pas limitative :
Si le dossier du soumissionnaire n’est pas complet ;
S'il existe une preuve de collusion entre soumissionnaires ;
Si les offres financières ne se situent pas dans la fourchette comprise entre 15 % au-dessus et 15 % en dessous du budget estimatif de référence, elles pourront être considérées comme non recevables.
Seules les offres ayant atteint le seuil minimum de 70 points sur 100 pourront être considérées pour l’attribution finale.
L’attribution finale tiendra compte de la combinaison entre score technique et score financier, avec la qualité technique restant le critère déterminant.
Les offres arrivées en retard ne seront pas prises en considération.