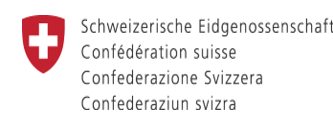Introduction
1. Introduction et contexte
Dans le contexte de crise multidimensionnelle (sécuritaire, politique, économique, sociale et humanitaire) d’Haïti la violence basée sur le genre (VBG) constitue un risque de protection majeur pour les femmes et les filles. Elle est alimentée par un système sociétal patriarcal profondément enraciné. La VBG revêt différentes formes (physique, psychologique, sexuelle ou économique) en fonction du contexte spécifique socio-économique, politique, sécuritaire, environnemental etc. Dans le Sud, zone prioritaire de la Suisse , les normes et structures patriarcales légitiment la VBG ainsi que la dépendance économique des femmes au sein des ménages. Dans cette région à dominante rurale, la sphère familiale émerge comme l'espace principal de ces violences conjugale et domestique et de l'exclusion. Dans la Zone Métropolitaine de Port-au-Prince (ZMPP), la violence armée s’ajoute à ces défis structurels. Les groupes criminels (GC) ont progressivement augmenté leur contrôle dans la ZMPP à environ 85% mi-2025. Les GC utilisent de manière systématique le viol (collectif), les agressions sexuelles, les enlèvements suivis d’agressions sexuelles, etc. pour terroriser et dominer les populations dans leurs zones d’influence.
Pour le premier trimestre 2025, 1’741 cas de VBG ont été rapportés, chiffre probablement sous-évalué.
En 2025, 1.5 M de personnes ont besoin de protection en raison de VBG en Haïti. Les principaux groupes vulnérables face aux risques de protection sont les femmes et les filles, les enfants et les jeunes, les déplacé.e.s internes, et autres groupes marginalisés. La situation est particulièrement difficile pour plus de 1.3 M de personnes déplacé.e.s internes (PDI), qui représentent 61% du total des survivant.es. La faiblesse/absence des institutions étatiques (police, services juridiques, services médicaux, etc.) constitue des barrières considérables à la protection des femmes et des filles contre les violences. L’accès aux services de prise en charge holistique (hébergement, services psychosociaux et médicaux adaptés, assistance juridique, etc.) demeure extrêmement limité. Le peu de services disponibles sont souvent inaccessibles à cause de l’incapacité économique à se doter de la logistique nécessaire ou à cause de l’insécurité générale. L'utilisation de ces services comporte des risques de représailles pour les survivant.e.s et les référent.e.s, ce qui justifie le besoin de systèmes de référencement adaptés qui sont gérés localement. Le manque de connaissance des services de prise en charge disponibles pose un souci majeur d’accompagnement des survivant.e.s de VBG. Cette méconnaissance du système résulte, entre autres, d’une faible coordination entre les acteurs VBG clés (faute de ressources humaines et financières, d’outils et d’approches adaptées, etc.). Enfin, dans ce contexte, les mesures de prévention contre la violence sexiste et les normes patriarcales revêtent une importance cruciale.
En vue d’apporter une contribution à une réponse articulée face à cette crise multidimensionnelle en Haïti, la Suisse accorde un intérêt particulier à la construction de la résilience des populations ciblées et de la protection des groupes vulnérables, tenant compte des effets et conséquences de la violence à leur égard.
En ce sens, la Coopération Suisse (CS) en Haïti dispose de trois programmes en lien à sa stratégie 2025-2028, dont un en particulier Amélioration de la protection des populations les plus vulnérables d’Haïti (A3PV) dédié à la protection des femmes et des filles, incluant les groupes minoritaires contre la VBG. Dans un contexte hautement fragile où les normes sociales de genre sont jumelées à la faiblesse du système de protection, la Suisse veut que personne ne soit laissé de côté.
En effet, la CS, via le programme A3PV, contribue à l’objectif 1 de la Stratégie de coopération internationale de la Suisse 2025-2028 (« Sauver des vies, alléger la souffrance humaine et soutenir l’accès à des services de base de qualité pour les populations les plus démunies »), ainsi qu’à l'objectif de développement durable #5 (égalité entre les sexes) et #10 (inégalités réduites). Au niveau national, ce programme s’accorde avec le plan national de lutte contre les VBG de 2023 à 2027 et suit la dynamique des lignes directrices de la politique d’égalité femmes hommes 2014-2034 d’Haïti.
Depuis 2019, la Suisse a subventionné des actions ponctuelles dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince (ZMPP) dans le domaine de la protection, visant à accompagner des acteurs locaux et internationaux dans la prévention et la réponse à la VBG. Il en résulte qu’une approche holistique de prise en charge couplée à la prévention fournit de meilleurs résultats et que le changement durable des pratiques nécessite des actions à long terme.
Le programme A3PV s’appuie sur cette leçon apprise et cherche à améliorer la protection et renforcer la résilience des communautés avec un focus spécifique et exclusif sur la VBG.
Le programme A3PV travaillera sur trois piliers en lien étroit avec les trois effets poursuivis : réponse (« life saving measures »), prévention de la VBG, et coordination dans le secteur afin de renforcer les deux premiers piliers. Le programme intervient dans le Sud et la Zone métropolitaine de Port-au-Prince (ZMPP).
Le programme serait implémenté par les acteurs suivants :
Pilier 1 – réponse (« life saving measures ») :
- ZMPP : Consortium des organisation non gouvernementales (ONG) Association of Volunteers in International Service (AVSI) et le Combite pour la Paix et le Développement (CPD)
- Sud : Fanm Deside
Pilier 2 – prévention de la VBG exclusivement dans le département du Sud :
- La CS lance le présent appel à propositions avec l’intention de trouver un partenaire en vue d’implémenter le volet « prévention » portant sur des méthodologies et approches novatrices dans le département du Sud (voir chapitre 3). Cette dynamique devrait conduire à un accord partagé de financement et l’implémentation d’une action articulée exclusivement sur l’objectif 2 du programme A3PV (voir chapitre 2 pour une description du A3PV).
Pilier 3 – coordination dans le secteur :
- United Nations Population Fund (UNFPA).
Consulter le lien ci-après pour toutes les informations relatives à l’appel à proposition : https://kdrive.infomaniak.com/app/share/838286/0083749e-c125-4248-a813-87a0b05f5c2c
Fonctions
Résumé du poste :
Cet appel à proposition se concentre sur l’effet 2 du programme A3PV qui vise la prévention. Il met l’emphase sur une série d’éléments non exhaustifs capables de guider le choix du partenaire pour les prochaines étapes. Le projet devrait être clairement formulé et devrait porter sur les points suivants :
1. Promouvoir des actions en lien à la prévention de la VBG au niveau communautaire qui porte sur le changement des normes, systèmes et structures sociales qui engendre la VBG selon les explications fournis dans le chapitre « 3.1. Besoins et spécificités de l’appel à proposition ».
2. Accentuer, maitriser et implémenter des approches et méthodologies de prévention de la VBG et le travail sur les masculinités positives innovantes telles « Champions du Changement », « Guérir ensemble », « Planter l’égalité » ou toute autre méthodologie pertinente. Des approches mixtes sont possibles.
3. Les organisations candidates peuvent se sentir libres de proposer toute démarche dont elles ont la maîtrise et dont l’impact a été prouvée objectivement dans des contextes fragiles dans le cadre de programmes préalablement mis en œuvre en lien à la prévention de la VBG et la promotion de la masculinité positive (selon ce qui est décrit dans le chapitre « 3.1. Besoins et spécificités de l’appel à proposition »).
4. Inclure l’objectif de mobiliser des OSC et OCB en tant que partenaires de l’action, qui seraient renforcées dans leurs capacités d’appliquer les méthodologies et approches utilisées par le projet. Le but c’est d’assurer la pérennisation des actions dans le futur avec ou sans financement. En particulier, le renforcement des capacités des OSC et OCB pour maitriser les méthodologies et approches innovantes de prévention de VBG constitue un axe clé du projet.
5. Le projet devrait idéalement déjà être élaboré ou en exécution en Haïti ; éventuellement cela pourrait être aussi un nouveau projet mis en place dans le délai requis pour cet appel à proposition, voir chapitre 6 « Calendrier »). Le projet peut être dans sa phase de mise en œuvre dans tous les départements d’Haïti. Toutefois, la proposition soumise à la CS devrait prévoir son extension au département du Sud d’Haïti. La CS ne pourra que co-financer la partie du projet dont l’implémentation se fera dans le département du Sud.
6. Pouvoir intégrer, dans la mesure du possible, des aspects de l’intersectionnalité du genre en lien aux minorités vulnérables tels les LGBTQI+, les individus vivant avec une déficience, etc.
7. Formuler la prise en compte du nexus : ce projet s’inscrit entre autres dans une logique nexus, sous-entendant le changement à moyen terme en lien aux situations de violences systémiques auxquelles les femmes et les filles ainsi que les autres groupes vulnérables sont en buttes au quotidien. En outre, les activités de prévention devraient ouvrir la voie aux dialogues communautaires plus importants sur la violence et les conflits. Par conséquent, le projet contribuera aussi au renforcement du tissu social et à l’inclusion ainsi que la promotion de la paix.
8. La gestion de programme sensible au conflit (GPSC) constitue partie intégrale de la stratégie d’intervention.
Qualifications réquises
Compétences et qualifications requises :
L'appel à propositions est ouvert aux candidatures des ONG internationales et des organisations haïtiennes qui répondent à certains critères clés. Des propositions de consortiums solidaires sont admises. Dans le cas d'un consortium, la composition des candidats doit garantir la complémentarité, la cohérence et la compétence dans tous les domaines requis. La CS prévoit de n'avoir qu'un seul partenaire contractuel. En ce sens, dans le cadre du présent appel à proposition, une seule proposition sera sélectionnée (soit d’une organisation individuelle soit d’un consortium).
Les organisations devraient démontrer :
1. De l’expérience prouvée dans le domaine de la prévention de la VBG. En particulier, le changement de comportements individuels et collectifs (niveau communautés) afin de transformer les normes, systèmes et structures sociales y inclus le travail avec les hommes et les garçons (masculinité positive).
2. De l’expérience et expertise prouvées dans l’utilisation des approches et méthodologies spécifiques à la prévention de la VBG au niveau communautaire, incluant l’aspect de la masculinité positive selon les indications dans le chapitre « 3.1. Besoins et spécificités de l’appel à proposition ». Par exemple, les approches et méthodologies telles « Champions du Changement », « Guérir ensemble », « Planter l’égalité » ou des approches mixtes peuvent être proposées. L’organisation doit démonter son expérience à travers des projets qu’elle a implémentés avec succès dans le passé.
3. De l’expérience prouvée dans la formation et du renforcement des capacités des OSC et OCB au niveau de la communauté concernant ces méthodologies et approches pour la prévention de la VBG (voir « 3.1. Besoins et spécificités de l’appel à proposition »).
4. De l’expérience prouvée dans la mobilisation communautaire en matière d’égalité de genre et la construction de réseautages viables et porteurs de changement.
5. De la capacité prouvée dans l’implémentation de projets dans un contexte complexe et fragile avec gestion de budgets robustes requérant de la conformité à des procédures administratives et financières rigoureuses. L’organisation devrait inclure soit des lettres de recommandation de bailleurs antérieurs soit d’autres références pertinentes relatives à des actions en cours d’implémentation ou déjà mises en œuvre.
6. De l’ancrage communautaire et/ ou des partenariats avec des OCB/ OCS dans le département du Sud d’Haïti. Le cas échéant, une forte capacité de développer rapidement des partenariats efficaces de mise en œuvre avec des OCB/ OCS dans le département du Sud et explication sur le comment cela va se produire dans la proposition.
7. Une bonne connaissance des priorités du travail de la CS en Haïti (valeurs, objectifs, focus thématique, approches, stratégie d’intervention, priorités transversales, etc.).
8. De l’adaptabilité aux changements fréquents qui peuvent survenir dans un contexte de crise permanente, capitalisant sur les leçons apprises et poursuivre les actions. La proposition devrait inclure des pistes pour une éventuelle réorientation/ adaptation/ changement du programme en cas de crise.
Dossier d’appel d’offres
Envoyer le pli à
Contact et information
Coopération Suisse en Haïti
Direction du développement et de la coopération (DDC)
11G route de Montagne Noire
Pétion-Ville, Port-au-Prince
Tél.: +509 3886 1418
Email : portauprince@eda.admin.ch
Ouverture de pli
10/10/2025 à 12:28
Remarques contact
Autres remarques
Documents à soumettre
Les documents suivants doivent être envoyés directement à la Coopération Suisse en Haïti (voir adresse 5.1.) :
- Lettre de motivation signée par l'organisation ou le consortium (1 à 2 pages) comprenant le nom de(s) l’expert(s) disponibles et responsables du processus de soumission du projet. Les CV correspondants peuvent être joints en annexe.
- Document de projet (Prodoc) : Toutes les organisations qui répondent à cet appel à proposition se doivent de suivre le format mis en annexe pour la rédaction de leur document de projet. En cas de doute sur le contenu, la Coopération Suisse répondra sur demande aux questions qui lui seront adressées concernant le document (voir ci-après). Nombre de pages maximum 25-30, excluant les annexes. Il est essentiel de s’en tenir aux annexes mentionnées dans le document de projet. Des documents additionnels dont mention n’a pas été faite dans le format du Prodoc ne seront pas admis.
- Proposition financière selon le format en annexe :
a. Budget pour l'ensemble du projet (y compris la contribution de la CS et le cofinancement apporté par l'organisation ou le consortium) couvrant trois années d'intervention et précisant les principaux éléments de coût liés aux différentes lignes d'intervention ;
b. Rapport entre les coûts estimés et les résultats attendus de la proposition de projet.
- Lettres de recommandation de bailleurs antérieurs soit d’autres références pertinentes relatives à des actions en cours d’implémentation ou déjà mises en œuvre (voir chapitre 4.1., point 5).
- Les annexes supplémentaires ou les liens vers d'autres documents ne sont pas acceptés et ne seront ni lus ni pris en considération.
- Une organisation peut soumettre ou participer à plusieurs propositions.
- Langue des offres : Français
- Toute question des candidats sur des aspects de l’appel à proposition doit être envoyée via l’email à « portauprince@eda.admin.ch » en mentionnant dans l'objet le titre suivant : « Questions de l'organisation (nom de l’organisation) concernant l'appel à proposition A3PV – (date de l'envoi des questions) ». Toutes les réponses seraient publiées selon le calendrier ci-après (chapitre 6) et sous le lien suivant :
https://kdrive.infomaniak.com/app/share/838286/0083749e-c125-4248-a813-87a0b05f5c2c